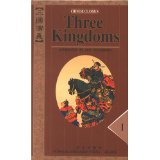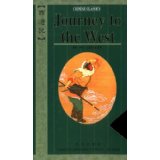J’ai mis du temps à me décider mais lorsque je me suis finalement lancée dans la lecture de ces quatre monuments, j’étais non seulement déterminée à relever le défi qu’une telle lecture représente mais j’avais également suffisamment de recul pour savoir que mon intérêt envers la Chine n’était pas que passager. Car, avouons-le, lorsqu’on s’engage à lire près de dix mille pages et qui plus est, en traduction, il faut tout de même s’appuyer sur de solides motivations. Et motivée je l’étais.
Du reste, depuis le temps que, passant devant le rayon de littérature chinoise de ma librairie, je reluquais les quatre boîtiers composant cette collection publiée par Foreign Language Press, chaque fois tentant d’en imaginer le contenu, inutile de dire que ce fut un véritable plaisir d’enfin les découvrir. Malgré les occasionnelles coquilles, un papier et une impression dont la qualité laisse parfois à désirer, le format des livres, les illustrations et la sensation de tenir entre mes mains un petit morceau de Chine, ainsi que le plaisir de la lecture, m’ont fait oublier ces petits désagréments.
* *
Shi Nai’an, Outlaws of the Marsh (Au bord de l’eau)
Traduit du chinois par Sidney Shapiro
♦
Au cours des années 1120, tandis que les Song du Nord, qui règnent sur la Chine depuis un peu moins de deux cent ans, assistent, sous la commande de l’empereur Hui Zong (un homme qui se destinait aux arts et lettres), au déclin graduel de leur nation, des hommes, issus de toutes les couches de la société, victimes d’abus, d’injustices et d’autres mauvais traitements, choisissent la voie de la rébellion. L’un d’eux, un certain Song Jiang, petit fonctionnaire sans prétention, se retrouve bientôt à la tête d’un groupe de gaillards dont les exploits, le sens de la justice et de la loyauté nourriront éventuellement les légendes.
Plus de deux cent ans plus tard (XIVe siècle), Shi Nai’an prend la plume et rédige les aventures de ces rebelles d’un autre temps. C’est ainsi qu’il nous donnera l’un des quatre grands classiques de la littérature chinoise.
Certes, Monsieur Shi prend quelques libertés sur les faits réels, mais le contexte et le récit ne manquent pas de dépeindre avec éloquence cette Chine des Song du Nord. Ce faisant, il propose au public de son temps ce qui constituera l’un des premiers textes de fiction en prose à paraître en Chine. Qui plus est, celui-ci étant rédigé en langue vernaculaire, une rareté pour l’époque, pourra ainsi rejoindre un plus grand nombre de lecteurs. D’ailleurs, le moment est propice pour le faire, car le peuple chinois (Han), privé du pouvoir et opprimé depuis qu’il vit sous le joug des Mongols (dynastie Yuan), est on ne peut plus disposé à accueillir ce récit, considéré dans sa version originale, comme un incitatif à la rébellion.
‘Au bord de l’eau’ raconte donc l’histoire, romancée, de ces hors-la-loi qui, alignés derrière 108 commandants, frères de sang unis à la vie à la mort, choisissent l’exil et luttent avec l’espoir de voir la justice enfin rétabli dans leur pays.
Roman de cape et d’épée rappelant, sur la thématique du moins, le ‘Robin des bois’ des Britanniques (XIIe-XIVe siècle), il peut également être considéré comme un roman historique, car au fil de la lecture, on y découvre divers aspects de la Chine du XIIe siècle. A l’époque c’est un pays déjà peuplé d’environ 100 millions d’âmes, dont les infrastructures et institutions diverses sont déjà bien constituées, avec une organisation sociale bien installée, une nation déjà riche en industries, commerce et technologies diverses, de même que dotée de stratégies militaires fort développées. Au surplus, le récit compte quelques exemplaires de poésie d’époque, tandis que sur le plan philosophique, en confrontant le bien et le mal, cette histoire qui met en avant quelques-uns des enseignements confucéens, illustre comment l’ultime pouvoir de sanctionner sur le monde des hommes relève inévitablement du domaine spirituel.
D’une construction linéaire simple, avec un marquage temporel que l’on peut qualifier de parcimonieux, ce roman nous convie à un véritable défilé de personnages, tous admirablement conçus et décrits, qui sont introduits, dans la mesure du rôle qu’ils assumeront, au moyen d’une petite histoire personnelle, suite à quoi, lancés dans la mêlée, ils participent à l’action et donc au récit qui nous est conté.
D’une envergure hors du commun, on peut aisément spéculer au sujet du temps et de la quantité de travail requis (ce qui tends à justifier la participation, disputée par certains, de Luo Guanzhong) pour produire ces pages remplies de personnages, d’aventures, de batailles, de festins et de surprises multiples.
Dans la suite de Shi Nai’an, une poignée d’auteurs ont relevé le défi, proposant d’autres versions (souvent adaptées aux circonstances politiques de l’époque à laquelle elles ont été écrites) de ce récit issue de la tradition orale. Une première traduction en japonais paraît en 1757 qui sera suivie par de nombreuses autres versions et adaptations, tandis qu’il faudra attendre jusqu’en 1933 pour lire le roman en anglais, et en 1978 pour accéder à une traduction française. Adapté pour la télévision et le cinéma à plusieurs reprises, le récit a également inspiré moult romans, BD, manga, jeux vidéos, etc.
Admirablement traduit par Sydney Shapiro, ce roman, tout en offrant une perspective sur l’histoire de la Chine, constitue un bon divertissement et une agréable façon d’aborder l’univers culturel chinois.
**
Luo Guanzhong, Three Kingdoms (Les trois royaumes)
Traduit du chinois par Moss Roberts
♦
Vers la fin du IIe siècle de notre ère, l’empereur Ling (dynastie Han), faible et vulnérable, dominé par une bande d’eunuques malicieux, trompé par des ministres envieux, abusé par des fonctionnaires corrompus et manipulé par une famille pas tout à fait unie, assiste passivement à l’affaiblissement graduel de son empire. L’insécurité et la colère mènent à la rébellion et bientôt, entre corruptions, complots, coercition, enlèvements, et autres coups d’états, le pays sombre dans une des périodes les plus chaotiques et les plus sanglantes de l’histoire de Chine. Une période de divisions, de conflits et de luttes armées au cours de laquelle, ressources matérielles et humaines seront drainées au-delà de toutes expectatives et qui s’achèvera par l’établissement d’une nouvelle dynastie, celle des Jin.
Les événements et personnages ayant marqué ce tournant de l’histoire entrent d’abord dans la culture par le biais des chroniques rédigées par l’historien Chen Shou. Mais bientôt ils inspirent également nombre d’histoires, de contes et de légendes pour la plupart transmises oralement, de même que des poèmes, des pièces de théâtre, des opéras, etc. autant de créations qui contribueront au patrimoine culturel de la Chine.
Puis au cours de la seconde moitié du XIVe siècle, tandis que la Chine traverse une nouvelle période de transition, un homme, s’inspirant des chroniques rédigées par Chen Shou ainsi que d’autres documents de sources diverses, rédige le roman des trois royaumes, un ouvrage qui sera éventuellement considéré comme le premier roman historique publié en Chine.
Bien que l’on attribue généralement la paternité de ce roman à Luo Guanzhong, la chose n’ayant pas encore été démontrée de façon irréfutable, demeure donc sujet à débat. Quoi qu’il en soit, on sait très peu de choses au sujet de monsieur Luo, si ce n’est qu’il aurait écrit quelques autres ouvrages d’une moindre envergure et qu’il aurait apporté contribué au roman ‘Au bord de l’eau’, autre classique de la littérature chinoise.
Rédigé dans un langage simple et factuel, ‘Les trois royaumes’ s’étale sur une centaine d’années, des années marquées par les conflits et autres luttes armées dirigées par des généraux rivalisant d’ingéniosité à l’usage des enseignements transmis par les grands stratèges militaires que furent Sun Zi et consorts.
D’épisodes palpitants en scènes dramatiques, l’auteur dresse peu à peu un portrait de la Chine du IIIe siècle et ce faisant, explore la relation existant entre les hommes, le pouvoir et la stabilité d’une nation. Imprégné de valeurs confucéennes à travers lesquelles on observe des traces de légisme, de taoïsme, de cosmologie, de divination (Yi Jing) et autres croyances, ainsi que quelques marques d’un bouddhisme en devenir, le récit permet également d’observer une large gamme d’émotions, de motivations et de comportements humains.
A prime abord, il pourra cependant sembler difficile de se repérer dans cet univers comportant un nombre important de ramifications, une foison de personnages, le tout se déroulant sur un large territoire dont les lieux autant que la toponymie ne nous sont pas forcément familiers. Ainsi, la préface et la postface, les plans, les illustrations, la liste des personnages, le glossaire et la synthèse chronologique proposés par l’éditeur sont autant d’outils appréciables. De la même façon, une série télévisée (en libre circulation sur le Web) produite en 2010 sous la direction de Gao Xixi, adaptée à partir du roman, constitue, ne serait-ce que pour l’aspect visuel, un excellent complément à la lecture.
Plus qu’un roman relatant un chapitre de l’histoire de Chine, ce récit, largement diffusé et étudié en Chine et à l’étranger, constitue une véritable plongée dans l’univers culturel chinois. Volumineux mais passionnant, ce classique de la littérature chinoise fera la joie des amateurs d’histoire et de culture asiatique.
**
Wu Cheng’en, Journey to the West (La Pérégrination vers l’Ouest)
Traduit du chinois par W.J.F. Jenner
♦
Sous la dynastie Tang, alors que la Chine vit une des périodes les plus prospères de son histoire, Xuanzang, l’un des plus grands traducteurs de sutras de Chine, part en Inde avec l’intention d’en ramener les textes bouddhistes qui contribueront l’implantation et au développement de cette religion en Chine. En tout, il met plus de treize ans pour accomplir cette mission dont les détails sont consignés dans un ouvrage portant le titre de ‘Rapport du voyage en occident à l’époque des grands Tang’.
On peut aisément imaginer qu’à une époque où les échanges commerciaux avec l’ouest vont bon train, ces longs voyages vers et depuis l’étranger marquent les esprits et font les délices des conteurs et autres artistes en quête d’auditoire. Ainsi, divers récits s’inspirant du pèlerinage effectué par Xuanzang ne tardent-ils pas à circuler sur les places publiques, puis ils sont adaptés pour le théâtre, etc, jusqu’à ce qu’au XVIe siècle, soit environ 900 ans plus tard, Wu Cheng’en (auteur présumé) compilant et révisant diverses versions ou parties de cette histoire, en propose un récit complet qui fera bientôt l’unanimité.
Outre plusieurs versions remaniées, le roman a été traduit en Japonais (version abrégée), dès la fin du XVIIIe siècle et début XIXe siècle.
Une première traduction en anglais par Timothy Richard parait en 1913, puis d’autres traductions lui succéderont. Deux versions abrégées sont proposées en français en 1924 et en 1957 (une version complète est proposée chez La Pléiade). Au surplus, le roman a inspiré de nombreux films, téléfilms, films d’animation, BD, peintures, musiques, danses, etc.
Considéré comme l’un des romans fantastiques les mieux réussis pour l’époque, ‘Xi You Ji’ s’est donc taillé une place de choix non seulement dans la culture populaire, mais aussi parmi les grands classiques de la littérature chinoise.
Véritable voyage dans un univers où le fantastique se marie avec la mythologie, ce roman illustre par ailleurs comment le bouddhisme, introduit en Chine dans le courant du premier siècle de notre ère, s’est graduellement intégré voire amalgamé au paysage religieux de l’époque pour constituer, avec le confucianisme et le taoïsme, ce qui peut être considéré comme l’essentiel de la pensée philosophico-spirituelle chinoise.
Après un court passage dans le domaine de la cosmogonie chinoise, on passe donc au VIIe siècle pour être bientôt entraînés à la suite du moine Tang Sanzang et de ses drôles de disciples, dans une série d’aventures au cours desquelles de nombreux vilains sont invariablement vaincus, tantôt par nos héros, mais le plus souvent par suite d’une intervention divine.
Narré sur un ton léger, cet ouvrage qui, dans la lignée de la tradition orale, se veut à prime abord un divertissement, fascine autant par sa richesse inventive que par les multiples interprétations que l’on peut en faire.
Au chapitre de l’écriture, on soulignera une judicieuse association de la prose avec le vers qui d’ailleurs sert admirablement bien cet univers fantastique et mythologique, mais dont la richesse grammaticale sonore et rythmique est considérablement diluée par la traduction.
Enfin, à l’instar d’autres classiques de l’époque, ce roman exhibe certaines faiblesses au niveau de la construction, ce qui tends à casser le fil narratif, tandis que par ailleurs, il fait un usage répétitif des mêmes procédés, ce qui a l’heur d’exacerber l’impression de longueur.
Ceci étant, qu’il soit envisagé en tant que roman fantastique ou comme un moyen d’appréhender le paysage mythologico-religieux chinois (auquel cas on préférera une édition annotée), ce roman constitue, aux côtés des trois autres grands classiques, une excellente manière de se plonger dans l’univers culturel chinois.
**
Cao Xueqin, A Dream of Red Mansions (Le Rêve dans le pavillon rouge)
Traduit du chinois par Yang Xianyi et Gladys Yang.
♦
Né dans le premier quart du XVIIIe siècle, Cao Xueqin était un homme de lettres particulièrement doué pour la poésie et la peinture, deux traits qui ressortent dans sa prose, notamment par la qualité de son écriture et la précision de ses descriptions. Il aurait investit plus de dix années à rédiger Hong Lou Meng/Le rêve dans le pavillon rouge (également connu sous le titre de Shi Tou Ji/Histoire de la pierre), un roman que certains croient avoir été inspiré par la vie de son auteur. Peu diffusé dans sa version initiale, il se fit connaître grâce à la publication qu’en fit Gao E à la fin du XVIIIe siècle et dont la popularité n’a d’égale que le nombre d’études dont il a fait et fait toujours l’objet à ce jour.
Partant d’une pierre dont l’origine est liée à la cosmogonie chinoise, le roman raconte les événements dont cet objet précieux fut témoin lors de son passage parmi les hommes.
Installée au sein de la famille Jia et plus précisément suspendue au cou du jeune Jia Baoyu, cette pierre précieuse observe et enregistre donc les faits et gestes de ceux qu’elle côtoie, constituant ainsi un récit qui nous est par ailleurs transmis par la plume de Cao Xueqin. C’est ainsi que le roman prend plus ou moins la forme d’une chronique des jours et des événements tels que vécus par les membres et personnes associées à cette famille influente de la Chine du XVIIIe siècle.
Au fil des scènes de la vie et donc au gré de cette quotidienneté, on découvre l’existence que mènent ces personnages, tandis que petit à petit apparaît le fil thématique animant cette histoire, à savoir que la nature illusoire des choses matérielles appelle à l’exercice du détachement, un état que l’on ne saurait par ailleurs atteindre sans préalablement avoir complété le cycle de sa destinée.
Ainsi, tout comme c’est le cas d’autres romans issus de l’empire du milieu, on retrouve ici les traces des croyances et religions diverses qui participent à l’univers spirituel chinois de même que l’on peut observer l’influence des principes confucianiste sur la morale sociale, familiale et individuelle.
Il reste qu’outre ce fond thématique philosophique, relativement mince par rapport à l’envergure de l’œuvre, avec un récit évoluant essentiellement au fil des événements qui animent l’existence d’une imposante maisonnée, on peut aisément qualifier Le rêve dans le pavillon rouge de roman “domestique”.
Riche de détails divers portant sur les us et coutumes, les règles sociales, les rites et cérémonies, les tenues vestimentaires, les croyances et superstitions, la médecine, l’art de la table, la vie sociale et culturelle, l’architecture paysagère, etc., c’est à un véritable bain socioculturel que nous convie cette œuvre et cela non seulement par le contenu mais également par la forme.
En effet, tandis que les récits proposés par les écrivains occidentaux ayant publié à la même époque (à titre d’exemple on peut citer Swift ou Chaderlos de Laclos) ont habituellement pour principal moteur soit l’intrigue et/ou le sujet abordé, inversement on constate dans ce roman que c’est dans l’enchaînement des scènes et au long de descriptions et de détails divers que le lecteur est amené à se constituer un portrait d’ensemble à travers lequel il pourra dans un second temps, percevoir le motif ou sujet du roman. Fossé culturel s’il en est, que certains lecteurs auront du mal à traverser et cela d’autant plus que ce roman volubile progresse lentement et dans une quasi absence de tension.
Outre cet aspect structurel, la spécificité culturelle marque également le contenu. Ainsi, plusieurs références et allusions littéraires, historiques, artistiques, etc., de nombreux poèmes au style inspiré par les grands maîtres de la poésie chinoise, ainsi que divers jeux de mots basés sur la constitution des caractères chinois qui les représentent, ou encore sur leur homonymie, risquent de n’avoir que peu de résonnance auprès du lecteur non initié.
De plus, ce roman dont le texte foisonne de subtilités linguistiques auxquelles il est difficile de rendre justice dans une autre langue, semble souffrir plus que ses pairs (i.e. Au bord de l’eau, Les trois Royaumes, La Pérégrination à l’Ouest) des aléas de la traduction. D’une part, il apparaît pratiquement impossible de transmettre la texture de la langue utilisée par l’auteur (soulignons que la version originale comporte deux niveaux de langues distincts, soit le dialecte de Pékin (ancêtre du mandarin) et le chinois vernaculaire), tandis qu’à cela, viennent s’ajouter d’autres difficultés telle que celle consistant à rendre la tonalité juste dans les dialogues (sarcasme, humour, ironie, etc.) qui, semble-t-il, aurait également tendance à mal traverser le cap de la traduction. Au vu de ces multiples difficultés, on ne peut que d’autant plus en apprécier la qualité du travail accompli par les traducteurs.
En dépit de cette incontournable distanciation entre le texte d’origine et l’interprétation dont le lecteur occidental pourra en tirer, Le rêve dans le pavillon rouge constitue une œuvre remarquable et fascinante. Traduit en plusieurs langues et sous plusieurs versions, il est à l’origine de nombreuses productions artistiques, et constitue, pour le lecteur occidental, un excellent moyen de se plonger et de découvrir un univers culturel d’une grande richesse.
©2015-2026 CarnetsLibres