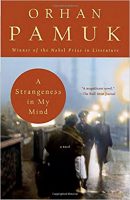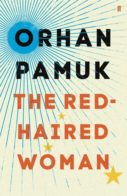Lauréat du prix Nobel de littérature en 2006 de même que couronné de nombreux autres prix et honneurs, lu à travers le monde, au fil des années et des publications, Orhan Pamuk a su construire une œuvre singulière et variée, une œuvre propre à plaire à une grande diversité de lecteurs. Bien qu’ayant apprécié à des degrés variables les romans que j’ai lu chez cet auteur, tous sans exception, ne serait-ce que par leur contribution au projet auquel s’est attaché l’auteur de nous faire découvrir sa ville natale et son pays, tous témoignent d’une originalité et d’une ingéniosité créative tout à fait remarquable. Rien que pour cela, ne serait-ce que pour cette raison, ces romans méritent que l’on prenne le temps de les découvrir. Mes impressions sur ceux des romans que j’ai lus à date seront présentées ici suivant l’ordre dans lequel ils sont parus pour la première fois. On trouvera donc sur cette page mes commentaires sur les romans parus au cours de la décennie des années 2000 et 2010: ‘Neige’, ‘Le musée de l’Innocence’, ‘A Strangeness in My Mind’ et ‘The Red-Haired Woman’ .
***
‘Le silence de la neige, voilà à quoi pensait l’homme assis dans l’autocar juste derrière le chauffeur.’
Neige
Traduit du turc par Jean-François Pérouse
Gallimard (2005)
♦
A la fois poétique, nostalgique et mystérieuse, c’est avant tout l’ambiance qui nous happe lorsque nous entamons la lecture de ce roman. Emportés par le défilé des mots, une fois arrivés à destination, nous nous imprégnons peu à peu de cette atmosphère tantôt comprimée, tantôt émerveillée, dans laquelle cette histoire d’amour et d’intrigues politiques va se dérouler.
Après avoir enterré sa défunte mère à Istanbul, Ka, un poète turc exilé en Allemagne depuis une douzaine d’années, décide de se rendre à Kars, une ville qu’il n’a pas revue depuis plus de vingt ans.
Isolée par la tempête, c’est à la veille d’une élection municipale que, dans les pas de cet homme, nous découvrons Kars, ville frontalière située à l’est de la Turquie, une ville appauvrie et animée par diverses tensions mettant en scène kurdes, islamistes, communistes, républicains et autres, qui se disputent raison et pouvoir.
Sous le prétexte d’avoir à rédiger un article pour le compte d’un journal stambouliote, Ka explore la ville et se frotte à ses habitants tout en cherchant, de façon plus ou moins consciente, à se défaire du mal-être qui l’habite, un mal-être dont sa plume, desséchée depuis plus de quatre ans, fait vraisemblablement les frais.
A Kars, tandis qu’il retrouve l’inspiration d’écrire et tombe follement amoureux, Ka est également mêlé à des événements troublants qui marqueront le cours de son existence.
Cette histoire, qui s’étale sur quatre jours, nous est racontée avec quatre années de recul par un ami de Ka dont la narration s’accorde par ailleurs plutôt fidèlement à la perspective du protagoniste.
A cette intrigue se greffe une exploration de divers aspects ou questions animant la société turque, tels que l’identité nationale et sociale, l’intégrité et l’intégration sociale, la liberté et le bonheur. Propos imposants, submergeant parfois une intrigue évoluant à un rythme plutôt lent, mais qui, sous la plume experte de Pamuk, capturent l’attention.
Toutefois, lorsqu’à mi-chemin du récit, le narrateur nous révèle l’issue de l’histoire, pari risqué s’il en est, en plus d’exiger un certain ajustement, ce revirement confronte directement l’intérêt du lecteur.
Hormis ce point sensible, Pamuk signe ici un autre roman de belle facture et livre de nouveau une œuvre dense et riche, propre à éveiller la curiosité et à susciter la réflexion.
***
Le musée de l’Innocence
Titre original: Masumiyet Müzesi
Traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy
Gallimard (2011)
♦
1975: proclamée année de la femme par l’ONU, la guerre du Viet Nam prends fin, la guerre du Liban éclate, le premier ordinateur à microprocesseur voit le jour, Bill Gates et Paul Allen fondent Microsoft, TFI diffuse des programmes en couleurs pour la première fois, David Bowie chante ‘Fame’, Joe Dassin chante ‘L’été Indien’.
Sise entre orient et occident, Istanbul emboîte le pas, mais tandis que ses habitants adoptent certaines modes et idées venues d’Europe, ils n’y sacrifient pas pour autant leur identité. Et cette identité, celle qui englobe et définit une nation, elle s’exprime tant par les comportements que par les objets dont on s’entoure. Que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire ou dans la façon dont nous décorons nos intérieurs, ces objets correspondent autant à une époque, qu’ils expriment ce que nous sommes. C’est ainsi que dans leur usage présent puis éventuellement dans les musées, ils montrent à la face du monde, ce que nous sommes en tant que nation.
Profondément attaché à son pays natal, Orhan Pamuk s’est donné pour mission d’en illustrer les particularités par le biais d’une œuvre littéraire qui, d’une publication à l’autre, rencontre fort bien cet objectif pour le bénéfice d’un large lectorat.
C’est dans ce cadre que s’inscrit ‘Le musée de l’Innocence’. Publié en 2008, ce roman raconte d’abord et avant tout une histoire d’amour. Plus précisément, il s’agit d’un gros plan sur une passion amoureuse vécue dans cet Istanbul de la seconde moitié des années 1970, une histoire ici racontée à la première personne, par un écrivain, alter ego de monsieur Pamuk, à qui le protagoniste a confié la tâche de transcrire l’histoire qu’il a vécue.
C’est avec force détails que nous entrons dans l’univers de Kemal, un trentenaire issu d’une riche famille d’industriels dont l’existence jusque là réglée et conforme à son milieu, est bouleversée par la rencontre de Fusun, une lointaine cousine, âgée de dix huit ans, issue d’un milieu pauvre et dont il tombe éperdument amoureux.
Sous le couvert de cette passion amoureuse, c’est la grande question du bonheur qu’explore ce roman, une question vue ici à travers le filtre des contraintes de classes et autres conditionnements sociaux propres au contexte turc. Une question donc qui met inévitablement en relief la notion de liberté.
C’est aussi un portrait de société que nous dresse Monsieur Pamuk, un portrait intimiste, dessiné au gré des objets, des intérieurs et de cette quotidienneté qui à long terme, donne forme à nos existences humaines. Un portrait tracé par une écriture sensuelle qui rends si bien compte des lieux comme de l’ambiance dans lesquels ils baignent, que l’on croirait y être.
Ce foisonnement d’objets donne éventuellement à voir le rôle joué et le poids accordé à toutes ces choses dont nous entourons et meublons nos existences, et qui sommes toutes, constituent un miroir de ce que nous sommes, une sorte de musée personnel, dont certains objets prendront un jour place derrière les vitrines de nos grands musées d’histoire et de la culture.
Puis de l’image ou du reflet de soi que dessinent ces objets, apparaît le concept d’identité. Celle de l’individu d’abord, puis de l’être social ensuite, suivi par l’identité nationale.
Comme c’est souvent le cas chez cet auteur, ces thèmes (le bonheur, la liberté, l’amour, les objets, l’identité) gravitent les uns auprès des autres tout en demeurant intimement amalgamés au récit. En d’autres mots, ils ne sont pas discutés comme tel, mais illustrés, ce qui donne lieu à un texte homogène aux tonalités essentiellement romanesques.
Cette impression est renforcée par une forte dose de ressenti intégré au corps du texte, un choix qui semble répondre à un impératif commercial (cet auteur jouit, du moins en Turquie, d’un lectorat majoritairement féminin) ce qui, étant donné une perspective unilatéralement placée du côté d’un personnage principal de sexe masculin, donne lieu à un curieux mélange des genres.
Par opposition, les personnages féminins sont essentiellement vus de l’extérieur et apparaissent comme des êtres évanescents, parfois passifs et souvent enfermés derrière les conventions et autres contraintes sociales.
D’un point de vue technique, ce roman est moins travaillé que les précédents, mais plus uniforme. Il évolue à rythme lent et peut sembler long par moments. Quelques répétitions sont difficilement justifiables dès lors qu’elles n’ajoutent rien au récit. Enfin, quelques clins d’œil (plus ou moins adroits) au roman qui a précédé celui-ci (Neige) confirment, de façon originale, une volonté de continuité dans l’œuvre littéraire de l’auteur.
‘Le musée de l’Innocence’ n’est sans doute pas celui des romans d’Orhan Pamuk qui m’aura le plus marqué, mais il constitue un joli morceau s’ajoutant au portrait que, d’une œuvre à l’autre, l’auteur dresse de son pays.
***
A Strangeness in My Mind1
Titre original: Kafamba bir tuhaflik
Traduit du turc vers l’anglais par Eklin Oklap
Penguin Random House (2015)
♦
‘This is the story of the life and daydreams of Mevlut Karatas, a seller of boza and yogourt.‘2
Voici l’histoire de la vie et des rêveries de Mevlut Karatas, vendeur de boza et de yaourt.2
Né en 1957 dans un village pauvre d’Anatolie, l’existence de Mevlut prend un tournant décisif lorsqu’à l’automne 1969, il part à Istanbul en compagnie de son père. A l’instar d’autres garçons ayant grandi en région, après avoir terminé le premier cycle d’études dispensé par l’école du village, c’est dans le but de poursuivre et compléter ses études secondaires qu’il migre vers la ville. Il est alors âgé de douze ans et découvrant la ville pour la première fois, ses yeux ne sont pas assez grands pour absorber tout ce qu’il voit. Tout en partageant le quotidien du paternel qui, comme bien d’autres hommes en ces années-là, est venu à Istanbul pour tenter de gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille, Mevlut explore son environnement et apprend le métier de marchand de boza, un métier auquel il restera attaché toute sa vie. Outre la compagnie de son père, il connaîtra le réconfort ainsi que les petites trahisons auprès de la famille de son oncle paternel, il rencontrera l’amitié avec Ferhat, l’amour avec Rayiha puis la spiritualité avec le Saint Guide.
Complémenté par un sous-titre, un arbre généalogique, une chronologie des événements, un index des personnages et une présentation stylisée, ce roman exhale un agréable parfum d’autrefois. Mais tandis qu’en substance il n’est pas sans rappeler certains classiques du XIXe siècle, adoptant par ailleurs une structure non linéaire (le roman commence alors qu’on se trouve au mi-temps de l’histoire contée) ainsi qu’une narration polyphonique, il s’inscrit par la forme, dans un style plutôt contemporain.
Essentiellement construit autour de l’histoire de Mevlut donc, ‘A Strangeness in My Mind’ a pour objet de retracer par le moyen de la fiction, la cinquantaine d’années au cours de laquelle, passant d’environ deux millions d’habitants en 1962 à plus de douze millions en 2012, Istanbul a non seulement connu une croissance vertigineuse, mais elle a également subit une expansion défiant nombres de préceptes du développement urbain.
Sur fond de jeux politiques, de manigances, d’allégeances, de trahisons, de coup d’état, d’élections, de secousses sismiques, de dessous de table et d’activités mafieuses, c’est essentiellement l’Istanbul des migrants issus du monde rural dont il est question ici, l’Istanbul des gagnes-petits qui, dans un contexte en ébullition, tentent de se tailler une place au soleil.
Au fil de cette histoire on retrouve certains des thèmes chers à l’auteur, notamment celui de l’identité; l’identité individuelle explorée ici via l’expérience migratoire, et l’identité nationale, vue dans sa complexité, via le tissus humain qui la nourrit autant que par les croisements entre l’est (la tradition) et l’ouest (la modernité) dont est témoin cette région.
C’est par le biais d’une multitude de personnages, dont certains agissent en tant que narrateurs, que ce tableau sociohistorique prend forme, exprimant ainsi une large palette d’expériences et de points de vues, un procédé qui a pour avantage d’étendre la perspective à laquelle nous avons accès, mais qui malheureusement se traduit, en raison du nombre, par un tracé souvent superficiel; en bref, les voix narratives ont tendance à se ressembler tandis que la psychologie des personnages manque parfois de précision.
Objet d’une attention particulière, le boza en tant qu’héritier d’un passé lointain et en tant que témoin des changements qui se sont opérés dans ce coin de pays, joue un rôle primordial dans ce roman.
Boisson à base de céréales fermentées dont on retrouve des traces en Anatolie et en Mésopotamie jusqu’au 9e siècle avant J-C., le destin du boza est intimement lié à l’histoire de cette région. Suivant les époques et les circonstances qui leur sont propres, tantôt consommé librement, tantôt décrié en raison du faible taux d’alcool qu’il contient (environ 1%), le boza constitue ici l’un des moyens/symboles dont l’auteur se sert pour illustrer le passage du temps, l’évolution des mœurs et finalement, l’histoire socioculturelle (voire géopolitique) d’Istanbul.
Enfin, à l’instar de ses prédécesseurs, ce roman parle également d’amour; l’amour ou l’attachement que l’on peut développer/éprouver envers une ville, l’amour d’un métier et/ou d’un style de vie, et bien sûr, l’amour d’une femme, de la famille, de la filiation.
Puis, tel que l’on peut l’observer dans nombre de ses romans, du formidable tableau qu’il trace ici, transpire l’hommage que rend invariablement l’auteur envers sa ville natale, ses habitants, son histoire, ses anecdotes, ses secrets.
Adoptant une approche romanesque du portrait sociohistorique, on pourra reprocher à cette œuvre de rester à la surface des choses, voire de verser parfois dans la guimauve, mais cette formule, qui sans doute permet d’éviter certains écueils, a l’avantage de permettre à une large palette de lecteurs de découvrir, grâce à un guide qui ma foi sait fort bien la raconter, l’une des multiples facettes de la Turquie.
Notes:
1.Titre français: Cette chose étrange en moi.
2.Première phrase du roman; la traduction française est de moi.
***
The Red-Haired Woman1
Publication originale, 2016
Traduit du turc vers l’anglais par Ekin Oklap
Faber & Faber, 2017
♦
Ayant déjà lu cinq romans signés par Orhan Pamuk, c’est avec un sentiment d’anticipation et non sans éprouver une petite crainte d’être déçue que j’ai ouvert “The Red-Haired Woman”. Mais dès les premières phrases, la magie ‘pamukienne’ opérant de nouveau, c’est avec le sourire aux lèvres que j’ai poursuivi, curieuse de découvrir à quel sujet de réflexion et quel genre d’histoire l’auteur allait me convier.
A l’encontre de ses prédécesseurs et sans doute en réponse aux remarques proférées par ses fidèles lecteurs, le dixième roman de ce nobélisé et auteur parmi les plus lus à travers le monde, s’avère d’une étonnante brièveté. Court et servi par un texte plus aéré, il n’en cède cependant pas en substance et nous plonge, toujours avec autant d’habileté, dans cet univers unique où Pamuk a su faire son nid.
‘The Red-Haired Woman’ raconte l’histoire de Cem, un homme qui à l’aube de la cinquantaine, revisite son passé et ce faisant dévoile comment, entre concours de circonstances et actes délibérés, quelques événements vécus à l’été de ses dix-sept ans (1986) auront finalement concouru à définir le cours de sa vie.
Composé de trois parties, le récit nous emmène dans un premier temps aux abords d’Öngören, une ville (fictive) située non loin d’Istanbul, où le jeune Cem, embauché comme apprenti, découvre aux côtés de Master Mahmut, les différentes facettes du métier (traditionnel) de puisatier. En plein processus de maturation, traversé par une palette de sentiments qui l’incitent à agir de manière impulsive, Cem, ayant d’une part noué une relation de type père-fils avec son maître du moment, tandis qu’autre part il expérimente les prémices d’une passion amoureuse, va bientôt se trouver confronté à des circonstances auxquelles il ne sait pas répondre. A la suite de cet épisode qui ne dure qu’un mois, la seconde partie du récit détaille le parcours suivi par Cem au cours des années qui suivent. Entre mariage et évolution professionnelle, ce parcours est jalonné par un questionnement, une sorte de quête de soi, de sens et de vérité. Un parcours donc qui le mènera jusqu’au faîte de sa vie, moment où il sera directement confronté par son passé. Enfin, narrée par la flamboyante Gülcihan (la femme aux cheveux roux), la troisième partie du récit complémente et revisite depuis un point de vue différent (féminin), les événements auxquels nous venons d’assister.
Classique roman de passage à l’âge adulte revêtant éventuellement l’apparence d’un fait divers au premier plan, ‘The Red-Haired Woman’, s’appuie toutefois sur un fond thématique aux multiples ramifications, un fond omniprésent, dont l’influence et la présence se fait sentir tout au long du récit. Ainsi, superposée à des récits classiques ayant quelques affinités avec le récit2, on réalise assez rapidement que l’histoire racontée dans ce roman sert de motif pour introduire et développer divers sujets de réflexions.
Dans un premier temps et d’un point de vue global, évoquant la notion d’archétype, une notion qu’il explore alternativement sous l’angle de la création littéraire et (suivant la pensée jungienne) sous celui de la psychologie humaine, on peut dire que ‘The Red-Haired Woman’ pose la question suivante: l’existence humaine ne serait t’elle pas constituée d’un ensemble de modèles fondamentaux formant une seule et même histoire que, d’une génération à l’autre, nous réinterprétons à travers le filtre des conditions dans lesquelles nous nous trouvons ‘ici maintenant’? Vu sous cet angle, le roman touche donc à des notions telles que le libre arbitre ou plus généralement celle du sens de l’existence humaine.
Puis en second plan, s’appuyant toujours sur divers classiques de la littérature, le récit explore également le thème de la relation père-fils et ses diverses implications, sujet à partir duquel il glisse vers celui du rapport existant entre la forme adoptée par un gouvernement et l’évolution d’une nation. A l’image de précédents romans, ‘The Red-Haired Woman’ aborde également le thème de l’identité et de la culture turque ainsi que celui des changements résultant du développement et de la modernisation de la ville chère à l’auteur.
Roman aux multiples facettes donc, doté d’une narration maîtrisée, dont la tonalité contribue plutôt bien à la crédibilité des deux personnages narrateurs. Plus succinctement développés, les personnages secondaires m’ont semblé moins convaincants. Servi par une prose nette, toujours soucieuse de sa précision, “The Red-Haired Woman”, est également parsemé de belles images, de passages à teneur poétique ainsi que de descriptions habilement tournées.
Enfin, tout en s’appuyant sur une construction relativement simple, le récit faisant brusquement volte-face, adoptant un autre point de vue ainsi qu’une nouvelle voix narrative à la troisième partie, (s’ajoutant à un dénouement quelque peu forcé), souffre il me semble, d’un léger manque d’uniformité.
Cela étant, Pamuk livre ici un roman stimulant, possédant un indéniable caractère universel qui, en dépit de l’envergure du contenu thématique, se lit aisément. Un roman à la lecture duquel la plupart des lecteurs devraient trouver de quoi satisfaire leurs attentes.
Notes:
1.Titre français: La femme aux cheveux roux (publication prévue en 2019).
2.Citons entre autres (pour la culture occidentale), ‘Oedipe roi’, pièce de théâtre composée par l’auteur grec Sophocle et (pour la culture orientale), ‘Rostam et Sohrâb’ une tragédie faisant partie de l’épopée Shâh Nâmeh composée par le poète persan Ferdowsî.
© 2015-2024 CarnetsLibres