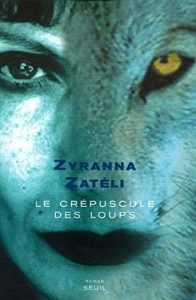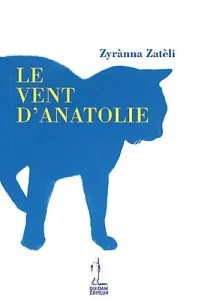Née en 1951 dans les environs de Thessalonique, après des études de théâtre, Zyránna Zatéli voyage un peu puis elle s’établit à Athènes. Après un passage dans le monde de la scène, elle se fait connaître en tant qu’écrivaine avec la publication en 1984 d’un recueil de nouvelles ayant pour titre La Fiancée de l’an dernier. Bientôt d’autres publications suivront. Le crépuscule des loups, son premier roman sort en 1993 et se verra décerner le Grand Prix d’Etat, honneur renouvelé en 2002 pour La mort en habits de fête. Sa production reste modeste mais elle s’est tout de même fait connaître hors frontières grâce à quelques traductions et publications dans divers pays d’Europe.
Le crépuscule des loups
Titre original : Και με το φως του λύκου επανέρχονται (Ed.Kastaniotis, 1993)
Traduit du grec moderne vers le français par Jacques Bouchard
Seuil, 2001
♦
Après l’agréable mise en bouche que fut Le vent d’Anatolie (voir ci-après), je m’étais promis de revenir vers cette auteure dès que l’occasion s’en présenterait. Chose promise, désormais accomplie par la lecture de ce Crépuscule qui s’est avéré aussi intéressant qu’hors du commun.
Roman en dix épisodes dont chacun explore une époque ainsi qu’un (ou plusieurs) événement (s) ayant marqué l’existence de l’un ou l’autre des principaux personnages, partant de la fin du XIXe et allant jusque dans les débuts du XXe siècle, Le crépuscule des loups nous plonge dans l’univers d’une famille dont les nombreux membres, établis dans un village de Macédoine, se répartissent sur plus de trois générations.
Délaissant les habituels constituants du roman (intrigue principale, linéarité, personnage principaux et secondaires, etc.), puis faisant l’impasse sur les repères d’ordre historique, social, politique voire même temporel, l’ensemble s’inscrit ostensiblement dans le cadre plus intime, onirique, et parfois surréel, de cette imposante famille.
Bref, sans autre ciment que celui dérivant des liens familiaux, qui du reste confèrent à l’ensemble sa cohésion ainsi que son unité de lieu et de temps, ce roman adopte donc une forme relativement morcelée. Mais n’en déplaise à certains lecteurs qui pour déconcertante qu’elle puisse être n’apprécieraient pas cette formule, si tant est que l’on conçoive cette lecture comme une illustration par immersion dans un monde qui, sis à un point tournant de l’histoire, serait, vu la distance, perçu de nos jours comme singulièrement mythique et réel, elle m’apparaît comme étant un choix judicieux.
Au fil des jours qui sont bien évidemment marqués par le passage des saisons, de même que par les naissances, les mariages, les morts, les joies, les peines, les drames, les fêtes et une multitude d’événements, on découvre toute une panoplie de petits riens mettant en relief divers aspects de la vie telle qu’elle fut vécue, ressentie et intériorisée en ces lieux et temps par les divers personnages que nous rencontrons.
Dans une langue teintée de régionalismes, le roman est servi par une narration qui n’est pas sans rappeler un certain mode (désormais oublié) de transmission orale à travers lequel, sous l’effet du temps et des mots, la réalité épouse peu à peu la forme du conte.
En partie constituées de souvenirs retracés par l’un des représentants de la troisième génération, tel un enchaînement de rêves, si elles défient parfois nos repères, dès lors que l’on accepte de se laisser bercer par les mots, ces histoires nous transportent tout doucement d’un point à l’autre, à travers des existences auxquelles l’auteure, dans une remarquable maîtrise de son art, nous convie.
Un roman copieux, mais envoûtant.
* * *
Le vent d’Anatolie
Nouvelle tirée de : Στην ερημιά με χάρι (Gracieuse dans le désert)
Ed.Kastaniotis (1995)
Traduit du grec moderne vers le français par Michel Volkovitch
Quidam Editeur, 2012
♦
Curieuse de découvrir l’écriture de cette auteure, mais n’ayant pas pu mettre la main sur l’un de ses romans ou recueils de nouvelles, en guise d’introduction, j’ai donc dû me satisfaire de cette unique nouvelle.
Narré avec le recul des années, Le vent d’Anatolie revient sur la rencontre que fit la narratrice alors qu’elle était encore enfant avec une femme prénommée Anatolie.
Souffrant d’une maladie s’apparentant à la tuberculose, Anatolie vit dans un isolement que seul le passage de quelques voisins venus lui apporter de la nourriture vient briser. Puis, lorsqu’à son tour la narratrice vient déposer un plat près de la demeure d’Anatolie, en dépit des interdits, attirée par l’aura de mystère entourant cette femme, la petite fille se rapproche, puis se lie d’une improbable amitié avec cette femme que l’on croit à la fois folle et extrêmement contagieuse.
Ce sont donc les souvenirs liés à cette première rencontre et à celles qui suivront que la narratrice nous livre avec toute la candeur demeurée intacte de son regard d’enfant.
Imagée et joliment ficelée, à la fois simple et ensorcelante, traversée par des effluves surréels voire oniriques, cette nouvelle qui évoque l’amitié et l’exclusion, se laisse si bien lire qu’une fois le récit terminé, on aurait envie de rester en compagnie de la narratrice afin de l’entendre nous raconter d’autres histoires venues du pays de son enfance.
Une voix singulière que j’espère retrouver bientôt.
©2015- 2026 – CarnetsLibres